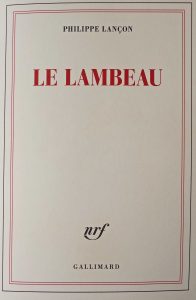L’éclatement de la chair : du sens des sens au non-sens.
On ne peut comprendre le brutal surgissement d’un sentiment de perte de son soi que si, comme le fait Philippe Lançon, le récit de ce qui apparaît (le moment phénoménologique) s’inscrit dans une conception plus générale de l’Etre (une ontologie). En cela les derniers chemins, souvent énigmatiques, parcourus par Merleau-Ponty notamment dans «L’œil et l’esprit» et «Le visible et l’invisible» consonent parfaitement avec les paroles de notre auteur. Et ce qui pouvait passer dans la bouche du philosophe comme des métaphores littéraires, «mon corps est pris dans le tissu du monde», « le monde est fait de l’étoffe même du corps», «les choses et mon corps sont faits de la même étoffe », « il faut retrouver le corps opérant et actuel, celui qui n’est pas un morceau d’espace, un faisceau de fonctions, qui est un entrelacs de vision et de mouvement», revêt dans «Le Lambeau», une particulière pertinence. Car pour qu’une atteinte grave du corps puisse trouer le tissu qui liait son être au monde, il faut qu’avec ce corps lésé, ce soit un monde, l’Etre même du monde, la chair qui se déchire. Car le corps, mon corps, est lié consubstantiellement à un invisible, l’Etre, d’où provient son sens et la perte de cette irrigation du sens transforme la chair du monde et de mon corps, en corps cadavre. Tel est le chemin qu’énonce cliniquement Philippe Lançon, passant brutalement d’un monde où corps-autrui-monde consonent, forment une même chair, à un chaos où l’autre est devenu cadavre, où la chair n’est plus que corps et où son monde n’est plus un monde.
Dans le tissu de l’existence, nous voyons le monde, autrui, le corps d’autrui, notre propre corps, dont nous comprenons le sens sans avoir besoin d’interpréter ce que nous en saisissons. Le visage d’autrui comme mon propre visage manifeste sans distance et immédiatement ce qu’il exprime ; il ne m’offre pas un ensemble de signes que je devrais déchiffrer par une sémiologie. Ainsi Philippe Lançon n’a pas à mobiliser son entendement pour saisir tout le sens de l’expression de Charb qui répond à son énervement de ne pas avoir obtenu un exemplaire du journal imprimé : «Charb a eu un sourire ironique et bienveillant qui signifiait : “Tiens, Lançon fait son caca nerveux !” De même, quand il arrive au journal et aperçoit ses amis, il ne se demande pas comme Descartes si ce sont des humains ou des automates. Et il en est ainsi quand le matin nous ouvrons les yeux sur le monde ou quand nous mouvons notre corps. Autrui, le monde, mon corps constituent une même chair, ce qui ne veut pas dire que monde, corps et autrui sont identiques : c’est une même étoffe aux motifs différenciés dont le recto et le verso ne sont pas identiques : identité de la différence et différence de l’identité.
J’ai un corps et je suis mon corps.
Ceci peut se comprendre si nous observons les liens étranges et ambigus que nous entretenons avec notre propre corps : nous disons tout aussi bien parfois que nous avons un corps ou que nous sommes notre corps. La destruction de la mâchoire va faire que Lançon aura un corps sans n’être plus totalement son corps auquel il ne peut plus momentanément s’identifier. De même, comme le montrent Husserl et, à sa suite, Merleau-Ponty, je peux voir ma main posée sur le clavier comme n’importe quel ob-jet du monde qui l’entoure : j’ai une main, j’ai un corps. Mais une expérience familière me livre un tout autre rapport au corps et au monde. Je pose ma main gauche sur la main droite que je vois sur le clavier ; ma première main devient touchante et ma main droite touchée, mais ma main touchée est en retour touchante, provoquant une véritable ré-flexion de mon corps sur lui-même et du corps sur les choses : «notre corps, écrit Merleau-Ponty, est un être à deux feuillets, d’un côté parmi les choses et, par ailleurs, celui qui les voit et les touche». Et ce qui est vrai du rapport à mon corps l’est aussi de mon rapport au monde, de mon rapport à l’autre. Quand je rencontre autrui et que je le vois, je deviens en même temps visible et de visible voyant. En serrant sa main, le chiasme de mon propre corps (sentant-senti, voyant-visible) s’élargit au corps d’autrui de sorte que «lui et moi sommes comme les organes d’une seule intercorporéité». Et les chiasmes du rapport à mon corps, du rapport à autrui, coexistent dans le chiasme du rapport de mon être et du monde dont l’artiste nous en livre l’essence : « entre lui et le visible, les rôles inévitablement s’inversent. C’est pourquoi tant de peintres ont dit que les choses les regardent». Corps, monde, autrui entrelacés appartiennent originairement à une même chair qui est Etre et sens de l’Etre, d’où s’engendrent leurs différenciations, de telle sorte que pour chacun il y a identité de l’identité et de la différence. Or, pour Philippe Lançon, il n’y a dans ce rapport de soi à soi et de soi à l’autre que des différences sans identité possible : « La voix de celui que j’étais encore m’a dit : “Tiens, nous sommes touchés à la main. Pourtant, nous ne sentons rien.” Nous étions deux, lui et moi, lui sous moi plus exactement, moi lévitant par-dessus, lui s’adressant à moi par-dessous en disant nous. »
«Je ne sentais rien, ne voyais rien, n’entendais rien».
On connaît les récits de Montaigne et de Rousseau qui tentent, sortants d’un coma, d’énoncer leur renaissance au monde. «Tout entier au moment présent, écrit ce dernier, je ne me souvenais de rien ; je n’avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m’arriver ; je ne savais ni qui j’étais, ni où j’étais…. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant auquel… je ne trouve rien de comparable dans toute l’activité des plaisirs connus « . Pas de conscience donc pas de temps, pas de sujet, pas d’espace, pas d’objet, mais seulement un état, de l’Etre éprouvé comme bonheur. Mais pour Philippe Lançon, la conscience est là, et comme toute conscience elle est visée de quelque chose ; elle atteint bien des choses : cris, mouvements, garde du corps de Charb, pistolets etc., mais elle ne parvient pas tout de suite à leur donner un sens car elle ne correspond plus à ce savoir originaire du monde qu’est le sentir. La chair n’existe plus, le monde se délite et l’invisible qui étayait et donnait sens à son existence disparaît au profit d’un invisible purement physique, objectif : «j’attendais simultanément l’invisibilité et le coup de grâce – deux formes de la disparition». Tout se fige ensuite par la disparition de la conscience dans une anesthésie sans objet : «je ne sentais rien, ne voyais rien, n’entendais rien». Son corps comme « entrelacs de vision et de mouvement» (M.P) a disparu.
«ça, c’est blessure de guerre»
Puisque le lien organique avec le monde est brisé, frappé par la solitude, ce « sujet » désormais solipsiste ne peut renouer avec le monde que par sa conscience intellectuelle. Tel le sujet cartésien qui affirme que la perception est une inspection de l’esprit, il est une res cogitans (chose pensante) essayant de rejoindre une res extensa (une chose étendue). Mais les différentes façons dont sa conscience se rapporte au monde se mélangent désormais de telle sorte que, perception, mémoire, imagination se confondant, le réel est flottant, réel et irréel sont indiscernables. Ne sentant pas ses blessures, «monté sur microscope», il explore son corps devenu chose parmi les choses, comme un anatomiste objectiverait et interpréterait ses organes, comme la médecine réparatrice le contraindra à les nommer et les objectiver. Ce rapport intellectuel au monde lui permet, par la distance qu’il crée, de ne pas ressentir la mort de ses amis. Il ne veut percevoir de son ami Bernard que le crâne, objet anatomique, res extensa, pour ne pas voir la personne, l’autre, le sujet anéanti. Mais les dents brisées ne peuvent pas être réduites dans sa bouche au statut de simple chose inerte : chez l’homme la sensation, comme le montre Proust qui l’aidera plus tard à supporter sa vie hospitalière, est riche de tout un monde, ici de l’enfance, du jeu des osselets, du dentiste : l’invisible d’où provient la possibilité du sens de notre existence se montre par instant au cœur d’un visible mutilé, insensé. Et c’est en retrouvant Sigolène, la rencontre d’un autre humain, qu’il sort de cette obligation d’interpréter des signes sur son corps et sur le monde.
Mais le nouvel objet transitionnel, son portable, qui condense alors pour lui tout son monde invisible (mère, frère, amis…), qui constitue la substance qui étaye son être, est ce qui provoque le retour catastrophique au réel, à son corps voyant-visible. Alors que l’enfant comprend par le miroir que, voyant, il est aussi visible, ce qui instaure un je spéculaire narcissique réunifiant un être qui sentait jusqu’alors un corps dissocié et qui voit un corps unifié, Philippe Lançon voit dans le miroir de son portable un visage dévasté auquel il ne peut plus s’identifier et que l’autre, parmi les premiers arrivants dans la pièce, n’aura pas la force de regarder. L’entrelacs voyant-visible, corps senti-corps-vu, intérieur-extérieur, moi-autrui, moi-monde, s’est dissous. Le regard qui se pose sur lui n’en est pas un : c’est une taxonomie clinique qui s’abat sur son corps-objet, «tas de viande et d’os à refaçonner» : «ça, c’est blessure de guerre».

 Publication sponsorisée
Publication sponsorisée